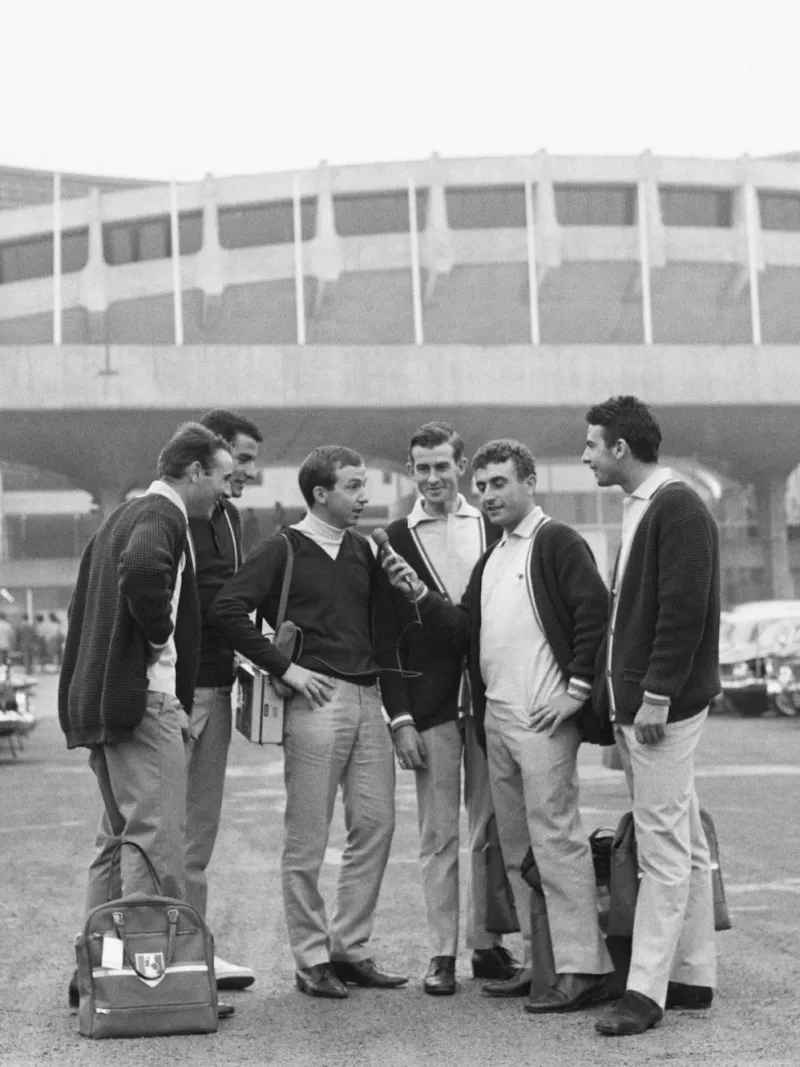Sébastien Plassard
Sébastien Plassard
Forces de la nature
15 min
2 min
Sommaire
Forces de la nature
Le ski survivra-t-il au réchauffement climatique ? À deux mois des Jeux de Pékin, les athlètes qui représenteront la France racontent ce rapport intime à la neige, mais aussi à la faune et à la flore. Une équipe de France à la fibre écologique, comme beaucoup de Français lorsqu’il s’agit de la neige. Et comme eux, avec leurs contradictions…
“À Tignes, les premières années où je venais, on pouvait skier, les deux tire-fesses étaient reliés. Désormais, on voit un gros rocher qui est sorti, donc on voit vraiment la différence…” Arthur Bauchet, skieur français paralympique en slalom et Super G, est en pleine nostalgie d’un monde qui, pour autant, n’a pas encore disparu, mais que le réchauffement climatique attaque jour après jour : le Grand Blanc. “Être dans la nature, quand tu es tout seul entre les sapins, entre les mélèzes, qu’il n’y a pas un bruit, tu es vraiment au paradis.” Mais jusqu’à quand ? + 2 °C dans les Alpes en plus d’un siècle (cf. encadré bonus). La prochaine génération pourrait ne plus skier sur de la neige naturelle.
Au départ, il y a le plaisir. Les mots de la romancière canadienne Antonine Maillet font écho à l’enthousiasme que chaque athlète continue d’avoir avec un élément qui renouvelle chaque jour le plaisir de la pratique de ces sports de haut niveau : “La neige possède ce secret de rendre au cœur en un souffle la joie naïve que les années lui ont impitoyablement arrachée.” Le skieur de fond Alexandre Pouyé a grandi dans un village à 1500 mètres d’altitude. Lui parle de “communion avec la nature”, et de longs entraînements en ski de fond : “Quand on fait trois heures tout seul, c’est aussi un voyage intérieur, on réfléchit à plein de choses, à la vie et, tout d’un coup, être interrompu par des beaux paysages et des animaux, c’est une belle partie du métier…” Vivre l’hiver avec la neige fait partie de sa vie. L’attente de la poudreuse aussi. Pour lui, la neige “n’est pas forcément de la nostalgie, mais le ski et les batailles de boules de neige, ça ramène toujours à des choses sympas”, comme “quelqu’un qui a vécu au bord de l’océan ou de la mer ressentirait la même chose”.
"QUAND ON FAIT TROIS HEURES TOUT SEUL, C’EST AUSSI UN VOYAGE INTÉRIEUR" ARNAUD POUYÉ


Face au loup
« Cette impression de voler… »
Dans ces disciplines, le cadre d’entraînement est loin d’être un détail : pour les membres de l’équipe de France, c’est pleinement un facteur de motivation. Quentin Fillon Maillet, biathlète de Saint-Laurent-en-Grandvaux, Jura : “Dès petit, j’ai eu cette expérience d’être enneigé tout l’hiver, donc c’est forcément un plaisir. Au départ, skier, c’est être en harmonie avec la nature, et c’est après seulement que la compétition est venue. En ce qui concerne l’environnement, on est bien au courant que le changement climatique est en route et nous influence. On est directement lié à la nature et au fil des saisons, on voit bien qu’il y a de moins en moins de neige. Ça remet beaucoup de choses en question.”
C'est également le cas pour le chef putatif de la délégation qui se prépare à rejoindre Pékin, Alexis Pinturault : “Pour moi, la montagne, c’est une immense beauté et diversité de paysages. Voir la neige, c’est un rêve pour beaucoup de monde, donc c’est la beauté que ça procure et la beauté des paysages que ça engendre. Notre délégation est extrêmement sensible à ça, parce qu’on le vit au quotidien, nous et notre fédération.” Car la situation a tendance à devenir dramatique. Dans sa station “assez haute”, Alexandre Pouyé a vu une diminution quasi de moitié de sa meilleure amie, “de 1 m de neige à 50 cm environ”. Pour celles et ceux qui viennent du Jura, du Vercors ou de la Chartreuse, c’est même encore différent, et également dans le Sud. Alizée Baron est née à Montpellier, mais a très vite habité à Orsières, et a sur la neige le même regard que les montagnards: “La neige c’est beau, c’est blanc, ça brille, c’est cool quoi ! C’est un lieu où je me sens bien, quand je suis à la ville, j’ai l’impression d’être Un indien dans la ville. Je serais beaucoup trop malheureuse si je passais plus de six mois sans voir la neige.” Les Alpes du Sud portent ainsi une histoire singulière. Maxime Montaggioni fait du snow, mais vit à Nice : “Je suis rattaché à Isola, mais on a aussi le Mercantour et un super patrimoine pour rider, c’est assez ouf, dans la même journée tu peux rider et te baigner, c’est quand même une localisation assez exceptionnelle.” Il compare assez vite la relation avec la neige, comme d’autres peuvent l’avoir avec l’eau, comme une échappatoire : “Quand tu habites en ville, tu es tout le temps oppressé. Quand tu vas en montagne, c’est l’inverse, le silence, l’espace, et c’est peut-être toi qui déranges plus les autres. Il y a cette sensation d’être comme en apesanteur, c’est quelque chose qu’on recherche dans le freeride.”


“Les stations de ski survivront-elles au réchauffement climatique ?”
 Alex Martin/Presse Sports
Alex Martin/Presse Sports
Quentin Fillon Maillet à l'entraînement à Bessans (Savoie) en août 2020
La lutte contre le réchauffement climatique, un nouveau sport olympique et paralympique ?
Si d’autres représentants français ont un tout autre rapport à la neige – tels Dorian Hauterville, originaire de Lyon, “venu au bobsleigh un peu par hasard”, ou Gabriella Papadakis, qui a grandi à Clermont et qui n’a pas beaucoup vu la neige en France – la préoccupation écologique est la même. “Quand j’étais petit, j’entendais qu’il y avait un réchauffement climatique, mais je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, confie Alexandre Pouyé. Ensuite, on est entré dans la phase où les gens plus vieux que moi me disaient: ‘Ah, quand j’étais petit, il y avait plus de neige, les glaciers étaient différents’, mais je ne me sentais pas non plus touché directement. La troisième phase dans laquelle je suis entré récemment, ces dernières années, c’est le vivre, le ressentir, et ça fait vraiment peur. Personnellement, c’est un gros gros stress, et je n’arrive pas à imaginer un avenir où ce que l’on fait là, ça puisse durer encore très longtemps…” Arthur Bauchet lui aussi le sait : “On est très mal placés pour parler d’environnement, car mine de rien, notre sport demande énormément à la planète, on en est conscients. On lui fait du mal quand on se déplace en bus en Europe, mais on essaye de limiter notre impact au maximum. Ça fait mal au cœur de voir les glaciers, les montagnes dans cet état. J’espère que la neige a encore un avenir. On est tous concernés, tous touchés par les questions environnementales. C’est notre sport notre métier, on est très proches de la nature.”
Alizée Baron, championne de skicross, partage les inquiétudes des autres membres de l’équipe : “En tant qu’athlètes skieurs, on est directement affectés. Quand on voit des glaciers, on se rend compte qu’ils ne sont plus du tout pareils, ils prennent vraiment cher d’année en année. On le voit, quoi, c’est super choquant, et il faut réagir vite, et en même temps, on prend conscience du fait qu’on a encore la chance de pouvoir skier sur ces glaciers-là, de vivre ça et de pouvoir encore en profiter.” Désormais, les comportements erratiques du climat commencent à se faire ressentir : “Il m’est arrivé des trucs incroyables, raconte Maxime Montaggioni : “Une fois à Tignes, un brouillard givrant, jamais vu ça. Tu fais un mètre, t’as tout sur le masque, c’est glacé, tu passes la descente à gratter ton masque pour essayer d’y voir quelque chose.”
 Alexis Berg/Presse Sports
Alexis Berg/Presse Sports
Glacier de Tignes, juillet 2018
"QUAND ON VOIT DES GLACIERS, ON SE REND COMPTE QU’ILS NE SONT PLUS DU TOUT PAREILS, ILS PRENNENT VRAIMENT CHER D’ANNÉE EN ANNÉE" ALIZÉE BARON
S’engager, malgré les contradictions
Si l’engagement est désormais nécessaire, chaque athlète cherche encore le meilleur endroit pour que son action soit la plus en phase avec la réalité de son empreinte carbone. Alexandre Pouyé : “S’engager ? Évidemment, quand on est sportif de haut niveau, on n’a pas vraiment le droit de dire qu’on est très engagé, parce que cet hiver, je vais prendre l’avion pour aller aux Jeux, donc pour l’instant, j’essaye encore de réfléchir à la manière de m’engager, mais je pense déjà qu’après ma carrière, je vais déjà bien bien réduire les voyages en avion, ça c’est sûr.”
Maxime Montaggioni ne se cache pas derrière sa responsabilité : “Peut-être que nous aussi, on participe à la dégradation, donc à côté de ça, je roule en hybride, j’essaie d’avoir des comportements plus écoresponsables. C’est sûr que je ne suis pas irréprochable, mais quand je vois un déchet, je le ramasse, c’est des petits gestes que j’applique au quotidien.” Un principe que Benjamin Daviet trouve nécessaire d’appliquer coûte que coûte : “On a la chance d’avoir une belle nature, en tant que skieur on en profite énormément, et il faut essayer de préserver cette belle faune, ne pas l’abîmer.”
Propos recueillis par Julien Duez et Léo Ruiz